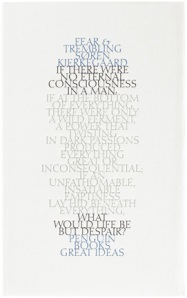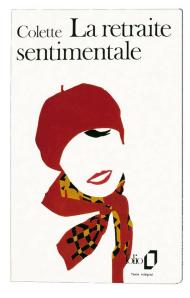L’oeuvre de Barbey d’Aurevilly est composée de trois parties bien distinctes. La plus connue – à juste titre – ce sont ses merveilleux romans et nouvelles. Si d’aventure vous n’avez jamais lu Les Diaboliques, L’ensorcelée ou Une Vieille Maîtresse, il faut bien entendu vous précipiter sur ces textes fiévreux, romantiques, et sensuels, oeuvre d’un conteur d’exception.
Puis l’oeuvre critique, publiée pour l’essentiel aux Belles Lettres. Barbey a vécu du journalisme et on le suit dans ses emportements, ses erreurs et ses jugements parfois visionnaires.
Et enfin, pour les fétichistes (mais si vous ne l’êtes pas, ce que publie Rue Fromentin ne va pas beaucoup vous intéresser), ses Journaux intitulés Memoranda. Il y en a quatre en tout, dans cette édition on ne trouve que les deux premiers, parce qu’ils forment un tout et retracent les années de jeunesse de Barbey, à l’époque où sa carrière littéraire n’était qu’à peine dessinée, et où le Connétable promenait ses manteaux extravagants et ses fleurs en boutonnière sur le Boulevard des Italiens ou à la rampe de chez Tortoni.
L’on y voit Barbey lire, tenter de percer dans le journalisme, énumèrer ses conquêtes réelles ou imaginaires, décrire chaque jour la lumière parisienne, s’ennuyer dans les soirées, admirer Byron et Brummel, passer des heures à sa toilette, et tenter d’appliquer dans les moindres actions de sa vie les précepte de ce dandysme dont il fut le génial théoricien.
Bref un merveilleux témoignage sur le dandysme, le Paris d’avant Haussmann, la vie sur le Boulevard, et pas l’ombre d’une piste sur la genèse de son oeuvre, même si les obsessions de Barbey s’y trouvent transposées. Mais peut-être est-ce mieux ainsi.